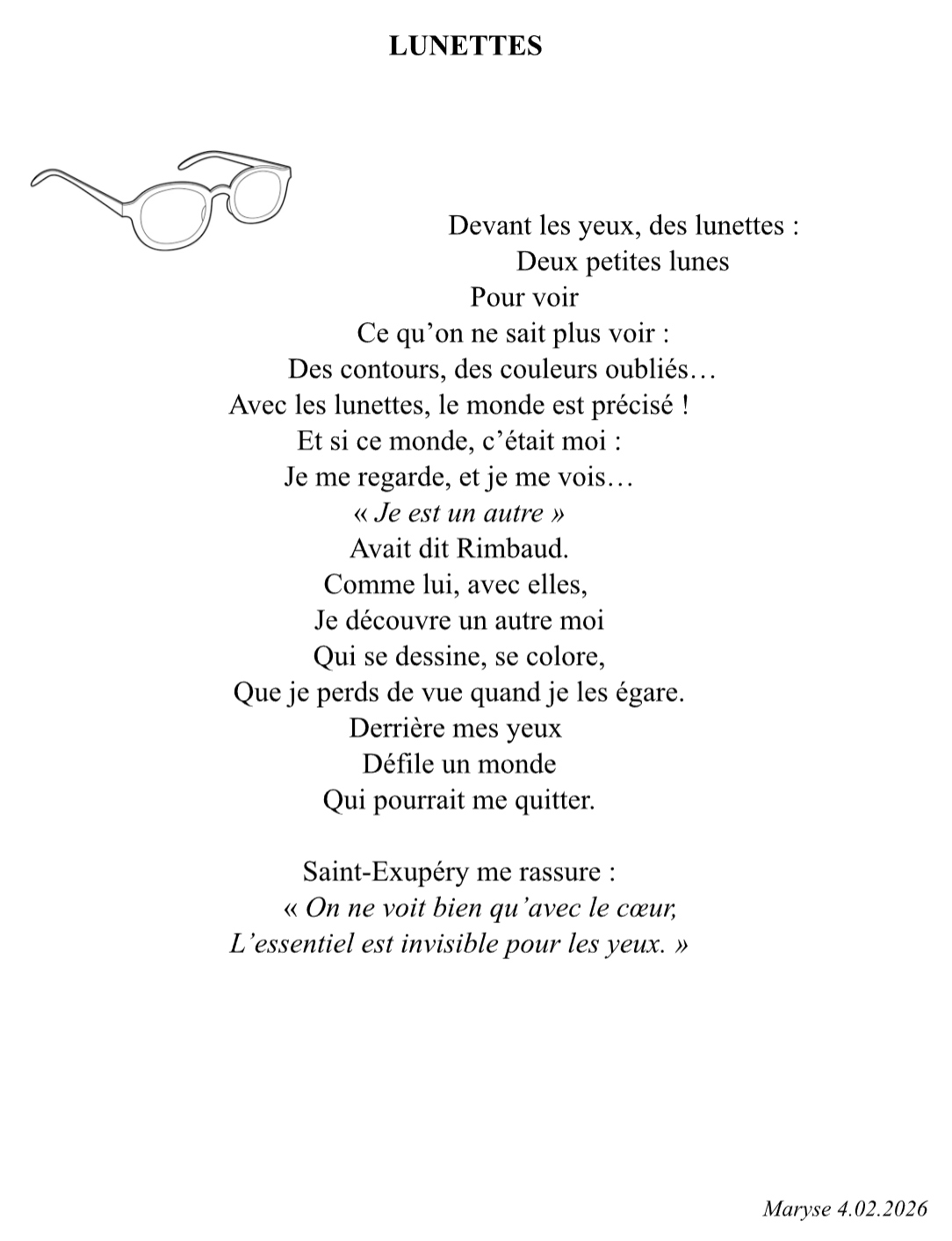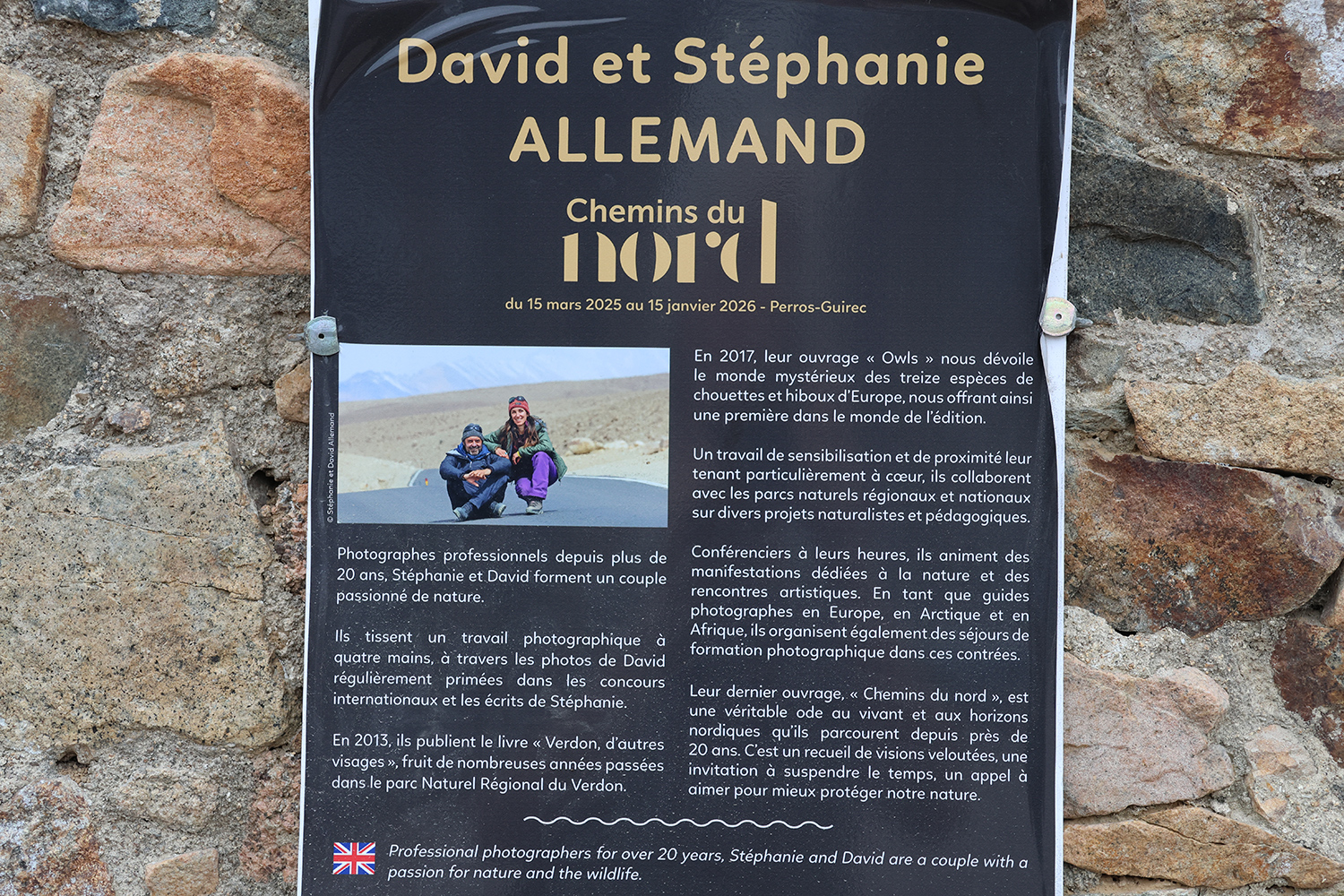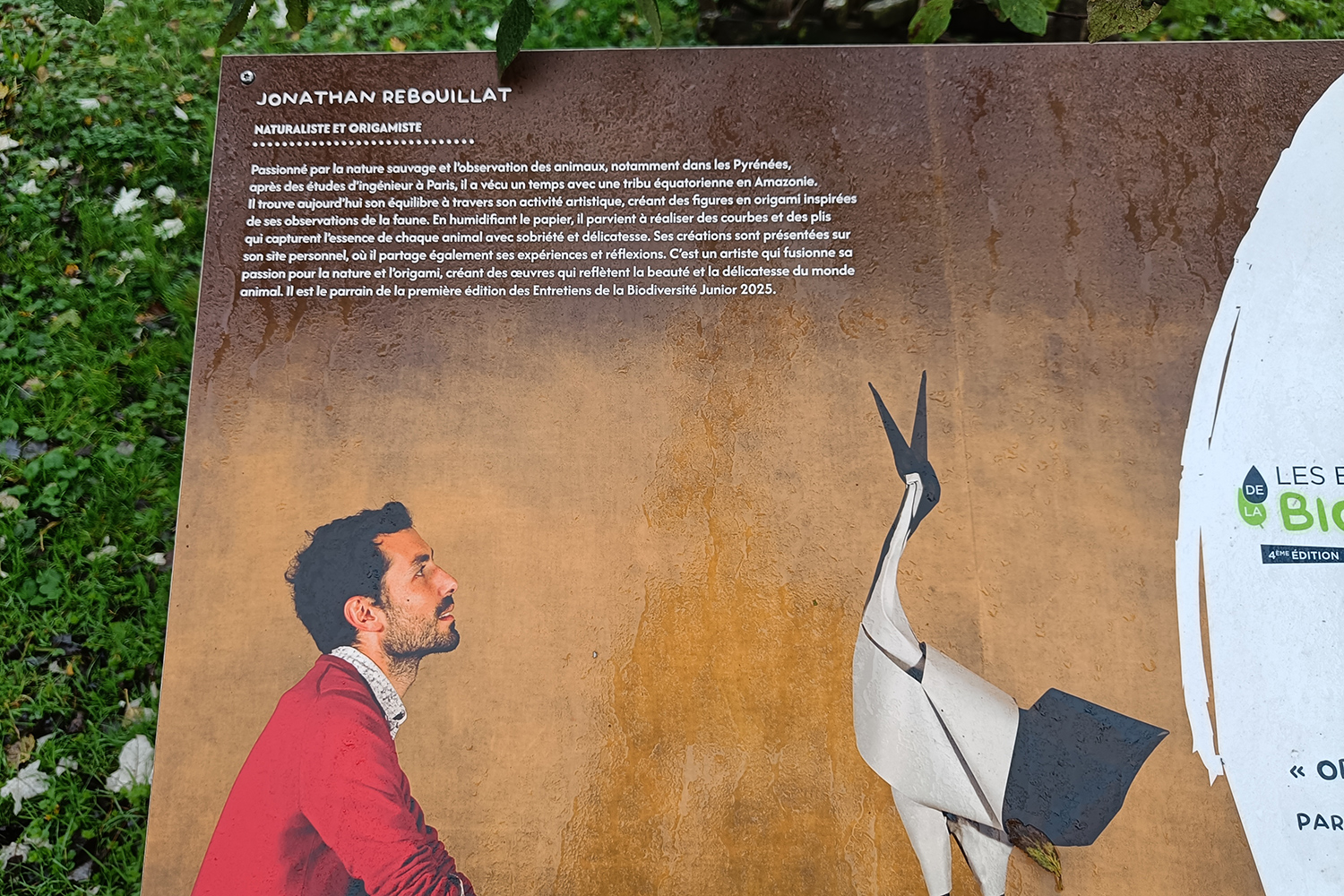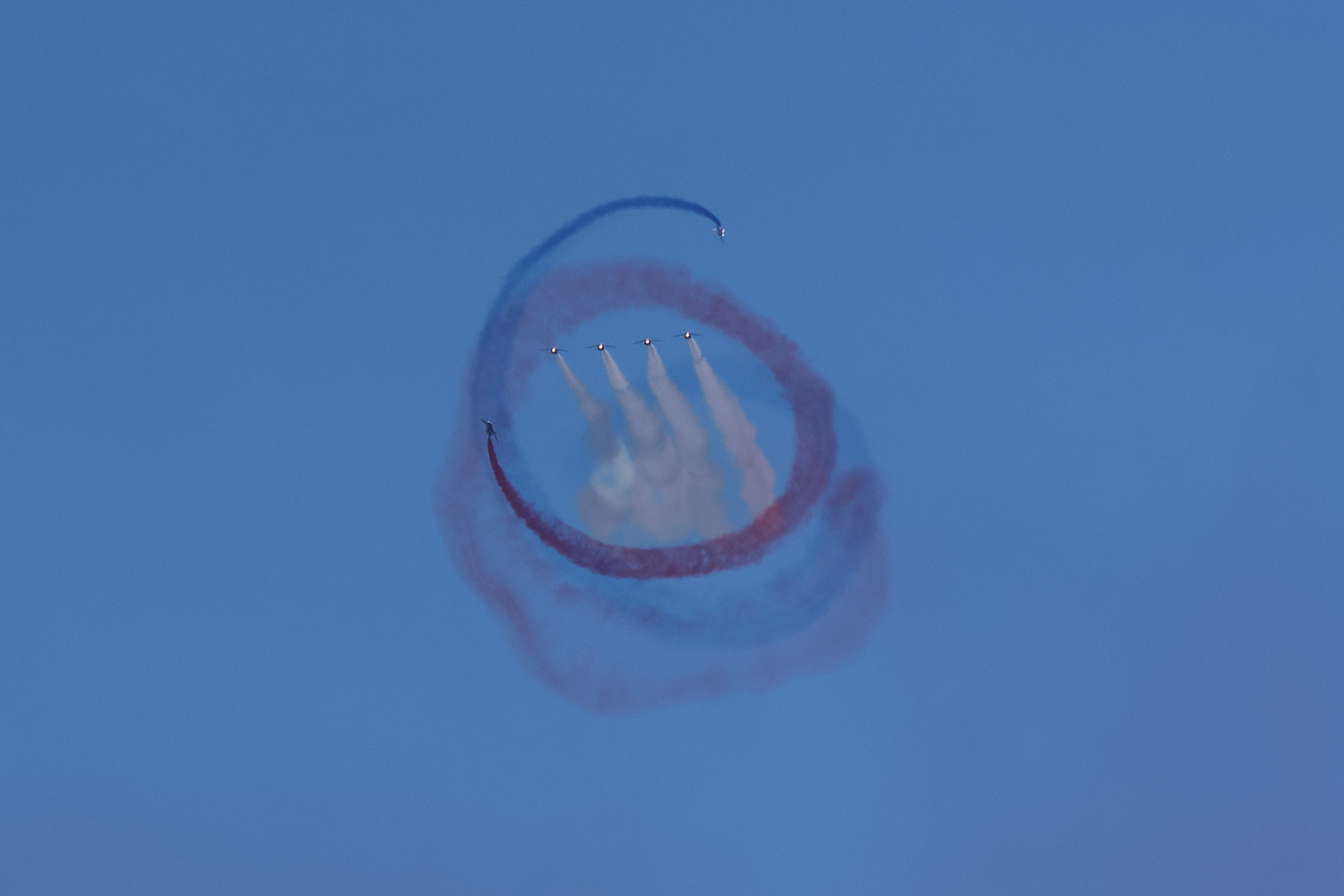J’ai envie de faire une petite pause d’une quinzaine de jours. Le prochain article paraîtra le lundi 2 mars. En attendant, je vous laisse avec un article sur le Milan royal.
Il n’est pas facile de trouver les mots pour raconter ce que je vis dans ma cabane où je passe une bonne centaine de séances d’affût par an, à voir un peu tout le temps les mêmes espèces, à savoir beaucoup de petits passereaux et surtout trois rapaces dont je ne me suis pas encore lassé : la buse variable …
… le milan noir …
… et le milan royal.
Concernant le milan royal, je le vois très souvent prendre de la nourriture en vol, en effleurant à peine le sol, mais il ne se pose quasiment jamais. Ainsi, pendant les 40 premières années d’existence de la cabane, je ne l’ai vu posé qu’à 3 ou 4 reprises, donc une fois en moyenne tous les 10 ans. Mais les choses ont commencé à changer en 2020 (je ne sais pas pour quelle raison). Maintenant il lui arrive de rester quelques instants au sol (mais jamais plus de quelques minutes) 2 ou trois fois par an. Ces jours-là sont des moments magiques pour moi.
En triant des photos il y a quelques mois (en vue d’une conférence que j’ai donnée à la fac de sciences en décembre), moi qui ne comprenais pas pourquoi je ne voyais jamais un seul milan royal juvénile à la cabane, je suis tombé sur quelques images faites fin août 2023 et je me suis rendu compte qu’en fait un juvénile (reconnaissable aux stries blanches des plumes) s’était posé au sol le 29 août de cette année-là. Comme d’hab, j’avais classé mes photos sans vraiment les regarder. Fait pas bon vieillir hein !?!

Et je me suis rendu compte aussi que cette année là j’avais été témoin de très belles scènes (je ne m’en souvenais que très très vaguement) et que je n’en avais pas parlé sur ce blog. Les photos de cet article sont donc des photos rescapées qui auraient dû croupir puis mourir quelque part dans un coin de mon ordinateur et qui n’en sont ressorties que parce qu’il fallait que je prépare une intervention.
Se poser au sol ne relève pas de l’évidence pour le milan royal …

… mais en plus, une fois posé, il faut garder la place face aux milans noirs (pas dangereux pour un sou) et la buse variable (dont il faut par contre se méfier un peu plus).
Alors le milan royal est très fébrile lorsqu’il est au sol. Souvent il s’envole à la moindre alerte.

Face à son cousin milan noir, le milan royal arrive à tenir à peu près la place.

Mais, par contre, c’est beaucoup plus compliqué et plus dangereux quand la buse arrive.

Face à la buse, le milan royal n’a souvent pas d’autre solution que de décamper et de revenir un peu plus tard en utilisant sa technique habituelle du chapardage, n’hésitant pas à ravir un peu de nourriture même entre les pattes de la buse. Souvent, celle-ci est imperturbable, elle ne bouge pas mais il arrive parfois que l’arrivée soudaine du milan royal la déstabilise complètement.

Il arrive quelquefois que le milan royal se perche tout à côté attendant un moment de calme pour venir à son tour.

Je rappelle que vous pouvez cliquer sur chaque photo pour l’avoir en format plus grand.
A tout bientôt.