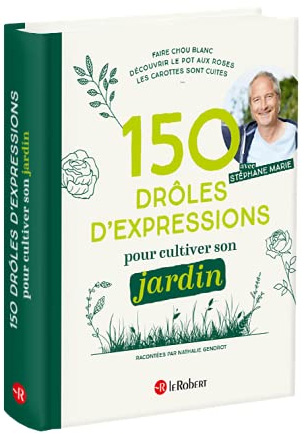Malgré un début d’année très sec, la saison au jardin s’annonce plutôt bien (« exceptionnelle » disent même les jardiniers de mon entourage, mais il faut rester prudent dans les prévisions, la sécheresse et la canicule peuvent ruiner bien des espoirs, tout est très fragile et provisoire dans la situation actuelle).
Année après année, les jardiniers de notre jardin partagé (on est une dizaine à faire du jardin dans le même lieu, 29 lignes de 65 m de long) sont tous devenus adeptes du travail de la terre. Les autres, ceux qui pensaient qu’il suffisait de semer puis de regarder pousser les légumes ont tous déserté les lieux. De fait, le jardin cette année, malgré les aléas météo excessifs, a de la gueule ! Voir les photos des deux bouts du jardin, faites ce soir.


Dans ce nouvel article consacré au jardin, je voudrais reparler du paillage permanent de la terre, même si je connais de moins en moins de personnes qui pratiquent cette méthode (je vois surtout des gens qui arrêtent cette pratique). On en parle souvent comme étant quelque chose de nouveau, or le fait de pailler est une méthode utilisée par les jardiniers depuis des siècles (mais évidemment moins qu’aujourd’hui, on ne l’utilisait qu’en cas de fortes chaleurs et sans doute que nos Anciens, s’ils vivaient aujourd’hui, l’utiliseraient un peu plus). Quand je dis « paillage », ce n’est pas nécessairement avec de la paille (cela peut-être toutes sortes de végétaux verts ou secs : tonte de gazon, BRF, foin, épluchures …) mais « paillage » est le mot consacré, je l’utiliserai donc souvent dans cet article.

Je pense que le principe n° 1 du jardinage n’est pas la couverture du sol mais le fait d’avoir absolument un sol meuble et aéré (pour que les racines progressent vite et pour que la circulation de l’humidité soit rapide). Peu importe comment on y arrive. Si on peut avoir un sol meuble par le simple travail de la terre, bravo ! Et si on peut l’obtenir par le paillage (ce que je ne sais pas faire), bravo aussi, mais c’est plus compliqué tout de même et peu de personnes y arrivent vraiment (je me souviens que lors d’une visite d’un jardin permacole dans lequel il y avait une production très faible de légumes, j’étais allé discrètement regarder sous le paillis, c’était dur comme du béton). Pailler ne signifie pas forcément avoir un sol meuble, loin de là !

Je l’ai déjà dit à plusieurs reprises sur ce blog : alors que les changements climatiques nous obligent à nous adapter en permanence (une année trop chaude et sèche, une autre trop pluvieuse …), on cherche à nous enfermer dans une méthode de jardinage unique, celle en dehors de laquelle il n’y aurait point de salut. Et le paillage serait la solution à tous les maux du jardinier.
Oui mais …
1 – Première remarque : L’argument « biodiversité des adeptes du paillage » ne tient pas. Ceux qui pratiquent cette méthode utilisent leur gazon pour couvrir le sol de leur potager alors qu’ils pourraient laisser leur pelouse aux sauterelles et aux grillons. Ils broient les végétaux de leur haie au lieu de laisser celle-ci aux oiseaux. Combien d’orvets, de couleuvres, d’escargots de Bourgogne, de carabes, … reste-t-il dans ce type de jardin ? J’ai un ami qui est arboriculteur en Belgique (Cédrock, et qui intervient de temps en temps sur ce blog) et qui plante chaque hiver des milliers d’arbres fruitiers. Il tient un discours que j’aime bien et dit facilement aux gens un truc du genre « si votre objectif principal est la biodiversité, ne faites pas un verger, plantez plutôt des buissons, laissez votre terrain en friche. Plantez un verger avant tout pour la production de fruits et évidemment ça servira aussi un peu à quelques espèces … ». Pour le jardin c’est un peu la même chose, la biodiversité, à l’échelle d’un terrain dont on dispose, ça se gère de plein de manières différentes et, dans tous les cas de figure, la partie potagère ne sera jamais la partie de votre espace la plus riche en biodiversité, gèrez plutôt les à-côtés du jardin (friche, grandes herbes, tas de branchages …) et faites du mieux que possible malgré tout pour la partie potagère.
2 – Dans certaines régions comme la Franche-Comté, les terres sont froides au printemps et se réchauffent lentement. Le paillage retarde encore le réchauffement du sol et la production de légumes n’en sera que plus tardive. Dans ces régions-là (et sans doute toute la moitié nord de la France + toutes les zones montagneuses de la moitié sud), le paillage ne peut-être qu’occasionnel et surtout pas permanent.
3 – Il est impossible de pailler un sol de type « terre battante », la terre devient très vite dure comme du ciment et les légumes vont s’étioler, faute de pouvoir se développer harmonieusement (exemple du sol limono-sablo-agileux que j’ai dans mon jardin et qui doit être travaillé constamment).
4 – Les végétaux (verts ou secs) que l’on met sur le sol pour effectuer le paillage consomment de l’azote en se décomposant (avant de le restituer plus tard). Les sols qui ont ce type de couverture sont donc bien souvent carencés en azote et les légumes auront bien souvent des feuilles qui tirent sur le jaune. Il faut souvent plusieurs années (le temps que le roulement entre matière organique fraîche et éléments nutritifs disponibles se fasse) pour arriver à un équilibre. Tous ceux qui se mettent à pailler ne savent pas qu’ils devront passer par des années difficiles (sol carencé en azote) avant de voir le résultat de leur action.
5 – Lorsqu’il ne pleut que quelques mm d’eau (ce qui est souvent le cas) le paillage empêche la pluie d’atteindre le sol, alors que dans un sol nu, bien travaillé, la moindre goutte d’eau sert à humidifier le sol. Et si, malgré le paillage, la pluie pénètre jusqu’au sol, celui-ci est effectivement maintenu humide grâce au paillage, c’est un avantage certain mais c’est aussi un très gros inconvénient : les racines vont alors rester en surface alors qu’au contraire la plante doit souffrir, aller chercher l’humidité en profondeur et développer un système racinaire qui lui permettra ensuite de résister à la sécheresse. Les jardiniers qui utilisent le paillage en sont réduits au final à utiliser bien plus d’eau qu’un autre jardinier (c’est pourtant l’inverse de l’objectif à atteindre) car les plantes qui n’ont pas de système racinaire bien développé ont besoin qu’on leur apporte de l’eau.
6 – Le paillage limite considérablement l’accès de la plante aux éléments nutritifs du sol. Je m’explique. Le volume des racines, c’est grosso modo une sphère. Le volume d’une sphère évolue au cube, c’est à dire que si l’on double le diamètre de la sphère, le volume est multiplié par 8. Un système racinaire qui a seulement 30 cm de diamètre (parce qu’on maintient l’humidité en surface grâce au paillage) bénéficie d’un certain volume de terre. Celui qui a 60 cm de diamètre (parce qu’il doit aller chercher l’humidité en profondeur) bénéficie d’un volume de terre 8 fois supérieur, c’est à dire qu’il puise dans le sol 8 fois plus d’éléments indispensables à sa croissance (azote, acide phosphorique, potasse … les fameux NPK) mais aussi 8 fois plus d’éléments lui permettant d’être en bonne santé et de lutter contre les maladies (minéraux, oligoéléments …). Personne ne parle de cela, aucun écrit sur le sujet, c’est pourtant évident, non !?!
7 – Le paillage favorise le développement inconsidéré des limaces. Un excès de limaces est inconstestablement un signe de déséquilibre du jardin.
8 – Le paillage, en maintenant une certaine humidité en surface, favorise toutes les maladies cryptogamiques, les deux principales étant le mildiou et l’oïdium.
9 – Contrairement à tout ce qui peut être dit, la technique du paillage et de son entretien prend beaucoup plus de temps que le simple travail de la terre à la serfouette. D’ailleurs, tous ceux qui pratiquent le paillage permanent du jardin, dépensent tellement d’énergie à cela qu’ils n’arrivent jamais à faire un jardin de taille normale, c’est toujours riquiqui, d’une taille insuffisante pour subvenir aux besoins d’une famille. Et le paillage n’empêche pas vraiment les « mauvaises herbes » de pousser (d’ailleurs dans les vidéos sur le paillage, on nous explique qu’on garde les herbes adventices … sauf que sur les images on voit toujours ces plantes adventices au stade « jeune », jamais au stade « graines », ce qui veut dire qu’en fait on a arraché les plantes au fur et à mesure de leur croissance, on n’a gardé les jeunes « mauvaises herbes » que pour le decorum de la vidéo).
10 – Les végétaux qui servent à pailler, on les prend où ? Evidemment si c’est pour avoir un jardin de 10m2, oui on peut, mais si on a un jardin de taille moyenne (ne serait-ce qu’1 ou 2 ares) on fait comment ?
11 – Le paillage empêcherait le travail fastidieux de la terre, c’est ce qui est écrit partout. Je ne comprends pas cet argument. Tous les jardiniers que je connais travaillent leur terre par plaisir et aucun ne considère le jardinage comme un travail. Les jardiniers qui trouvent que désherbage et travail de la terre sont fastidieux ont intérêt à vite changer de métier et à retourner devant leur écran (en mettant en fond d’écran une belle photo de jardin d’autrefois).
Je ne voudrais pas que mon texte sur le paillage soit considéré comme un plaidoyer anti-permaculture. Je suis à fond « anti-permaculture » mais si je suis contre cette « escroquerie des temps modernes », c’est pour bien d’autres raisons (des raisons de fond) bien plus importantes que le simple problème du paillage et sans doute que j’en parlerai un jour. Et surtout il faut bien comprendre que je fais le distinguo entre le paillage occasionnel du sol (que l’on pratique en été en période extrême – à partir d’août surtout – et qui a beaucoup d’avantages) et la couverture permanente du sol qui possède tellement d’inconvénients qu’elle ne peut être considérée comme la panacée universelle qu’on essaie de nous vendre à tous prix dans les livres d’aujourd’hui.
Alors, revenons à nos Anciens, paillons notre sol lorsque les conditions météos deviennent trop dures mais jamais avant le plein été, il faut toujours attendre d’avoir des plantes aux racines fortement développées. Cette méthode de paillage, uniquement lorsque cela devient nécessaire, est quelque chose d’efficace (on paille, on arrose abondamment et on ne touche plus à rien pendant plusieurs semaines).
Le problème avec le paillage permanent, c’est que l’on donne cette méthode en pâture à de jeunes jardiniers en herbe qui ne connaissent rien au cycle du carbone, aux types de terre, à la physiologie des plantes, aux maladies cryptogamiques … et qui se cassent le nez assez vite sur cette méthode (parce qu’ils ne savent rien des inconvénients cités ci-dessus). Alors, plutôt que de se pencher sur d’autres méthodes possibles, un jour ils arrêtent le jardinage (le concept de permaculture date de 1978, impossible de trouver quelqu’un qui ait pratiqué la méthode avant 2000 et qui la continue encore). Quel gâchis !
Je réfléchis à l’idée d’écrire un livre qui pourrait s’intituler « permarnaqu’culture ». A voir, si, vu mon âge avancé, j’arriverai au bout de ce projet … !
En tous les cas, la crise alimentaire majeure qui se profile au niveau de la planète (on a plein de signes avant-coureurs) va sans doute remettre en valeur nos techniques de jardinage ancestrales, basées sur un principe qui finalement a toujours bien fonctionné : l’huile de coude !