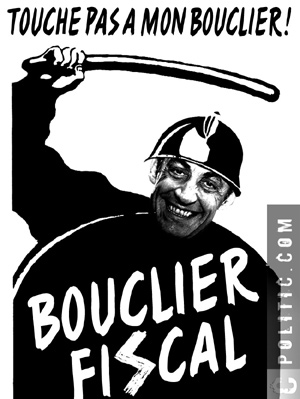Un petit dimanche musical proposé par Luc
C’est indéniable, historiquement, traditionnellement, le jazz, c’est une musique de noirs, c’est une musique d’américains. Elle trouve ses origines quelque-part dans le temps et l’espace entre la nouvelle Orléans et les champs de coton dans les états du sud des EU. Depuis près de cent ans, elle est un lieu d’expression d’identité raciale et culturelle. Elle porte dans son histoire les traces des tensions qui régissent les relations entre Noirs et Blancs, c’est à dire entre riches et pauvres, entre maîtres et serviteurs, entre sens et intellect.
Même si aujourd’hui, le grand brassage mondial a en partie fait son œuvre, même si le temps a construit maintes passerelles entre les deux parties, maintenant encore, un clivage existe, qui je l’espère, n’est plus un signe d’opposition mais au contraire une reconnaissance saine de l’existence de cultures multiples.
Aux États-Unis, le jazz, c’est d’abord la firme de disque Blue note (EMi), depuis 1939.
En Europe, c’est en Allemagne, en 1969, que va naître un première grosse maison d’édition de Jazz. Celle-ci trouvera dès le début de son existence, les moyens de cristalliser les spécificités du jazz européen, bien blanc, bien intellectuel diront certains, tellement froid diront d’autres que ce n’est plus du jazz. Pourtant, c’est avec un musicien Noir Américain, Mal Waldron que débutera l’aventure de la maison d’édition ECM (Edition of Contemporary Music).
Pourquoi un tel préambule ? Parce que Jan Garbarek, est un des musiciens phare de la maison d’édition ECM. Un chef de fil du son ECM, de l’esthétique ECM (*).
Vous n’aimez pas le jazz ? Essayez l’« ECM » !
http://www.youtube.com/watch?v=W7tM4-r7hHI&feature=related
Garbarek, c’est aussi ECM par son côté musique du monde. Il cultive l’art de s’entourer de musiciens venus du monde entier (et de tous les temps), d’intégrer à sa musique des sonorités lointaines sans pour autant nier son propre monde musical. On en trouve un magnifique exemple dans sa collaboration avec le quartet de musique ancienne « Hiliard Ensemble » (que j’ai mentionné dans le blog à la page Idée de cadeaux de noël 6, mais aussi ici, dans une collaboration avec Ustad Fateh Ali Khan).
Le petit Jan qui est né en 1947 à Mysen en Norvège, a depuis ce temps lointain enregistré près de 30 albums à son nom. Mais est-ce nécessairement dans ses propres albums qu’il s’éclate le plus? Je n’en sais rien. Ce qui est sûr par contre, c’est que moi je l’aime quand même un peu plus jazz, comme par exemple, toujours chez ECM, au service de la musique du contrebassiste Miroslav Vitous, avec Jack Dejohnette aux baguettes… Attention : musique.
http://www.youtube.com/watch?v=U5Txo3DhL_c
Je sais que sur ce blog, il y a quelques amateurs de jazz mais aussi encore beaucoup de monde à convertir. Alors, allons-y franchement.
En 1975, le pianiste Keith Jarrett enregistrait pour ECM, son fameux Köln Concert (**). Cette improvisation totale deviendra vite la meilleure vente de tous les temps de la maison d’édition.
Je vous propose une premier extrait, la totalité est facile à trouver partout sur le net.
http://www.youtube.com/watch?v=WFDb9oIw9xI
Je souhaite une toute bonne écoute aux petits veinard qui ne connaitraient pas encore ce morceau.