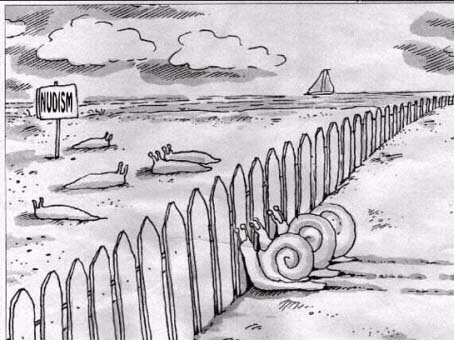J’achète très rarement un film, les DVD me semblant être condamnés à n’être regardés que peu de fois (un film qu’on aime bien, même génial, est-ce qu’on le regarde plus de quelques fois dans sa vie ?). Par contre, les DVD musicaux me semblent plus intéressants, j’y reviens en tous les cas beaucoup plus souvent, ils présentent aussi l’avantage de pouvoir être regardés « par petites touches ». J’adore en particulier les concerts : souvent l’image renforce tellement la musique !
Il semble que contrairement au CD audio, il n’y ait pas vraiment de règle en matière de prix, le même DVD pouvant être trouvé à des prix qui varient du simple au double, selon l’endroit où on l’achète, ce qui est assez inexplicable (peut-être que les marges sur ce type de produit sont énormes). En ce moment, il semble que les producteurs se soient enfin décidés à baisser leurs prix et certains DVD sont tombés à 12, voire 10 euros. Presque deux fois moins chers qu’un CD audio, l’image en plus, et parfois deux fois plus longs !
Récemment, je suis tombé sur un DVD live de Miles Davis, l’un des derniers enregistrements du trompettiste, enregistré à Paris en novembre 1989, un peu moins de trois ans avant sa mort. Une aubaine : ce DVD était vendu à Carrefour à 9,99 euros alors qu’il est à … 29,71 euros sur Amazon !

J’ai toujours aimé la musique de Miles Davis qui a profondément marqué l’histoire du jazz. Tous les trompettistes du monde entier se réclament de lui, mais seul le son de Miles Davis est reconnaissable entre tous. Il suffit de quelques notes … ! Peut-on rester insensible à cette musique ?
Le personnage de Miles Davis me semble complexe. Parfois arrogant (ou simplement provocateur ?). Je me rappelle d’une interview dans lequel il disait « quand une chemise me plait, j’achète l’usine ». Sur le concert de Paris, l’attitude de Miles Davis est conforme à ce qu’elle a toujours été sur scène : Miles semble indifférent à la présence du public, lui tournant parfois le dos ; lorsqu’il ne joue pas, il évolue en marchant entre les musiciens en mâchant un éternel chewin-gum, tout sourire semblant être proscrit de son visage. La solitude et l’autisme de l’artiste tout entier à l’accomplissement de son oeuvre ?
Mais il reste la musique ! De la grande musique ! N’y cherchez pas du travail de grand virtuose, il y n’y a que des notes essentielles, aucune fioriture ou avalanche de notes pour meubler le discours. Chaque note est épurée. Une grande sobriété et une grande économie de moyens au service de la musique avec un grand « M ». Miles Davis est entouré de musiciens hors pairs, notamment Kenny Garrett au saxophone (époustouflant dans Human Nature) et Benjamin Rietveld à la basse.

Vincent a très bien décrit la musique de Miles Davis. En effet, lorsque j’ai mis en ligne un article sur un autre grand trompettiste, Louis Armstrong, il y a quelques mois, il avait écrit dans un commentaire : « Armstrong me semble en effet autant extraverti, solaire, ouvert, souriant, foisonnant (il pointe sa trompette vers le haut, ou vers nous, lorsqu’il joue)… que Davis est introverti, lunaire, refermé, souffrant, parcimonieux (et pointe sa trompette vers le bas ou vers… lui). D’un côté la joie, la santé, de l’autre la beauté qui est toujours un peu maladive. »
Les puristes du jazz, ceux qui en sont restés au « kind of Blue » de Miles Davis, n’aimeront peut-être pas cette dernière période du trompettiste, avec claviers électroniques et percussions électriques. Dommage ! Qu’ils visionnent ce DVD qui pourrait les faire changer d’avis !